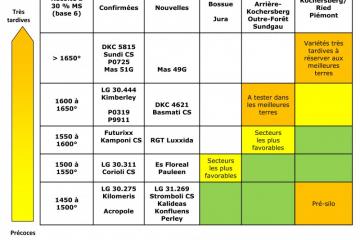Ensilages
Les conservateurs au silo peuvent améliorer les performances
Ensilages
Cultures
Publié le 03/02/2017
Ensiler les fourrages sert à allonger leur durée de conservation. L’opération consiste à les mettre en conditions humides et anaérobies afin d’obtenir, par fermentation lactique anaérobie, un produit acide, stabilisé, sain, et dont la valeur alimentaire est proche de celle du fourrage récolté en vert. « La qualité de l’ensilage dépend essentiellement de l’état des fourrages au départ et de la qualité de la mise en silo », indique Philippe Le Stanguennec, conseiller agricole à la Chambre d'agriculture d’Alsace.
Pour réaliser un bon ensilage d’herbe il faut donc privilégier de l’herbe jeune, riche en sucre, digestible, et qui se conservera mieux. « La période optimale de fauche se situe au stade début épiaison. C’est à ce moment qu’on enregistre un pic d’UF et de MAT à l’hectare. Ensuite ces valeurs plafonnent puis diminuent, il n’y a donc aucun intérêt à attendre », poursuit le conseiller. C’est pour profiter à chaque coupe de ces bonnes valeurs alimentaires qu’il est conseillé d’attendre environ six semaines entre elles. La durée de séchage du fourrage avant son ensilage dépend du type de flore, du pourcentage de feuilles, de la productivité et du type de prairie. « Pour limiter les pertes, il faut rechercher une teneur en matières sèches de 30 % pour les graminées, et de 35 à 40 % pour des légumineuses », résume Philippe Le Stanguennec.
Favoriser l’anaérobie
Le processus d’ensilage débute par une phase de respiration, durant laquelle les micro-organismes naturellement présents utilisent les glucides de la plante et l’oxygène présents dans le silo. Afin de préserver la valeur alimentaire du fourrage, cette phase doit être la plus courte possible. Il est donc important de favoriser l’anaérobie le plus rapidement possible. Car ce n’est qu’en absence d’oxygène que les bactéries lactiques prennent le dessus sur les autres (levures, bactéries acétiques conduisant à la perte de matière sèche et d’appétence) et produisent de l’acide lactique conduisant à une acidification rapide du milieu. Or il est important d’atteindre rapidement un pH de 4, car c’est là que le fourrage est stabilisé et que le métabolisme des bactéries indésirables est bloqué.
Pour favoriser l’anaérobie, la technique consiste à bien tasser le silo pour évacuer l’air. Puis il convient d’assurer rapidement et durablement la meilleure étanchéité possible. Une fois le silo ouvert, le front d’attaque du silo doit progresser régulièrement, « d’environ 25 cm par jour en été et de 15 cm par jour en hiver ». Lorsque les conditions d’ensilage sont bonnes, la perte de matière sèche entre le produit vert et fermenté est de 12 à 14 %. « En diminuant la protéolyse, en inhibant l’activité anaérobie des bactéries indésirables, et en améliorant la stabilité des ensilages, les conservateurs permettent de préserver 4 à 5 % de matière sèche », déclare Philippe Le Stanguennec.
Choix du conservateur : fonction du fourrage et de l’objectif visé
Le type de conservateur à mettre en œuvre dépend du type de fourrage et de l’objectif visé. En effet, tous les fourrages n’ont pas la même prédisposition à l’ensilage. « Plus la teneur en sucres est importante et plus le pouvoir tampon* est faible, plus le pH va descendre rapidement et se stabiliser ensuite », résume Philippe Le Stanguennec. Il faut donc distinguer la luzerne, caractérisée par un fort pouvoir tampon qui rend sa conservation difficile, des ray-grass, plus faciles à conserver parce que riches en sucres et de faible pouvoir tampon.
Face à des fourrages pauvres en sucres et riches en MAT, pour lesquels la diminution du pH peut s’avérer difficile à obtenir, il est possible d’apporter des conservateurs biologiques à base de bactéries homofermentaires (lactobacillus, pediococcus) qui vont à la fois diminuer le pH et limiter la fermentation butyrique. « Une solution qui convient aux fourrages ressuyés ou préfanés, et qui représente un coût de 20 à 40 €/ha. » Pour les coupes directement ensilées, une autre solution consiste à apporter de l’acide formique. Compter environ 45 €/ha.
Si l’objectif poursuivi est la stabilité à la reprise du silo, il est possible d’utiliser un conservateur biologique sous forme d’inoculum de bactéries hétérofermentaires, qui vont produire de l’acide lactique mais moins que des bactéries homofermentaires, et des acides gras volatils, qui vont limiter les risques d’échauffement et de reprise de fermentation au front d’attaque. Autre solution, plutôt pour des fourrages riches en sucres et avec une teneur en matière sèche élevée : l’utilisation d’acide propionique. Cette solution peut aussi être envisagée en été, sur un front d’attaque qui n’avance pas assez vite, ou dans la mélangeuse, si le fourrage chauffe à l’auge.
Sur du foin, l’utilisation de conservateurs est à réserver aux fourrages de haute qualité, type luzerne peu fanée pour préserver les feuilles, ou lorsque le séchage, donc la teneur en matière sèche, est insuffisant. Trois types de produits sont utilisables : l’acide propionique, des bactéries lactiques, et des extraits de fermentation de bactéries lactiques, avec un coût de 8 à 16 €/t fourrage. « Le plus difficile est d’estimer le rendement et la teneur en matière sèche puisque la quantité de conservateur à apporter doit être ajustée en fonction de la teneur en matière sèche. »
« La priorité doit être donnée à la bonne gestion de la récolte et de la mise en silo. Car l’utilisation de conservateur n’est pas nécessaire dans de bonnes conditions. Mais en cas de défaut d’ensilage, ou si on se trouve face à des fourrages riches en valeur alimentaire dont on souhaite réduire les pertes, il peut s’avérer intéressant d’utiliser un conservateur, à condition que son coût ne soit pas supérieur au gain apporté par la réduction des pertes… », conclut Philippe Le Stanguennec.