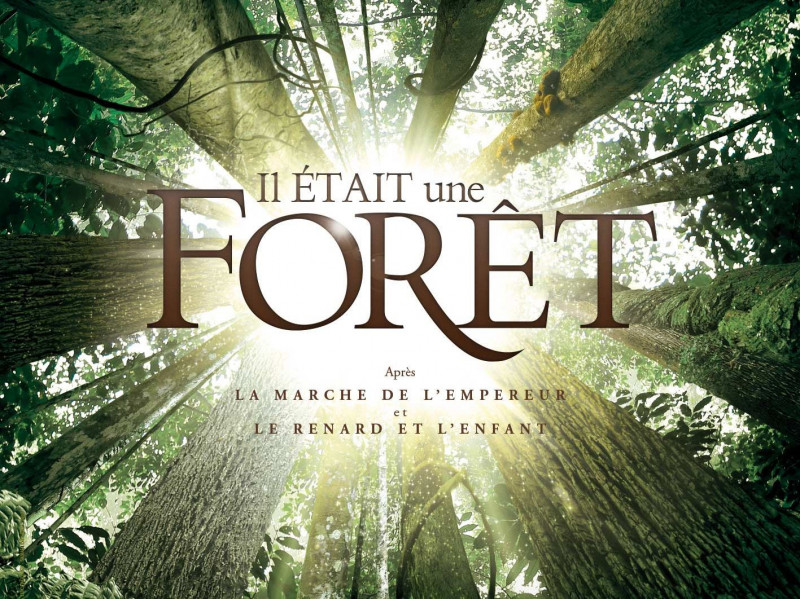Le 15 juin à Kehl, experts en élevage français et allemands ont confronté leurs diagnostics et leurs solutions lors d’une journée technique de clôture du programme Klimaco consacré à la résilience des élevages dans un contexte de changement climatique. Seule une combinaison de solutions permettra d’y faire face, ont-ils conclu.
Selon le rapport Copernicus, 2022 a été l’année la plus chaude sur l’ensemble de l’Europe de l’ouest depuis 1950 et la deuxième année la plus sèche. Conséquence : un déficit fourrager de 26 % en moyenne nationale, avec des pointes à - 40 % dans certaines régions. D'ici 2050, 2022 sera considérée comme « une année normale », prédit Serge Zaka, docteur en agroclimatologie, en faisant défiler cartes et graphiques à l’écran. « Toutes les productions devront être adaptées à ce nouveau contexte climatique. »
Les cumuls annuels de précipitations, relevés de 1961 à 2012, montrent déjà une France coupée en deux. Il pleut davantage sur une grosse moitié nord de la France et pourtant, la sécheresse s’accentue. « Ce n’est pas logique », reconnaît Serge Zaka. Avec un scénario d’augmentation des températures de + 3 °C (qui n’est pas le pire envisagé), les précipitations sur le sud de l’Europe vont baisser, mais les incertitudes restent fortes pour le centre de l’Europe. « C’est plutôt la répartition saisonnière qui va changer, avec davantage de pluies en hiver et moins de précipitations en été, prédit Serge Zaka. L’indice d’humidité des sols va se dégrader, selon l’intervenant, qui s’attend à « moins d’eau, plus d’évapotranspiration et des orages plus forts en été » entre 2070 et 2100.
Pousse de l’herbe : plus vite, plus fort
Côté températures, des canicules plus longues sont attendues : une dizaine de jours supplémentaires à plus de 35 °C pour l’Alsace, cite l’agroclimatologiste. Des conséquences sur les animaux et les cultures sont à prévoir. Les rendements moyens du maïs devraient baisser sous l’effet d’un stress hydrique et thermique plus intense. Au Nord, la variabilité interannuelle risque de s’accentuer. Les prairies vont se réveiller plus tôt, ce qui permettra aux animaux de sortir au pré de manière précoce. « Le pic de production printanier va se décaler dans le temps : les prairies vont produire plus vite et plus fort, annonce Serge Zaka, mais la pousse va s’arrêter en été et devrait reprendre à l’automne. Selon une étude de l’Idele, la luzerne devrait profiter de la hausse des températures avec un gain de 5 t/an/ha d'ici 2100.
Les périodes de canicule vont augmenter le stress chez les vaches laitières. Pour apprécier ce facteur, les spécialistes utilisent l’indice THI, qui associe température et humidité. « Plus il fait chaud et humide, plus le stress thermique augmente », ce qui provoque des effets à court et long terme. D’abord une baisse de la production laitière et la sensation de mal-être de l’animal, puis l’apparition de boiteries, liées à une station debout plus longue, une dégradation des performances de reproduction et de l’état de santé. Ce stress peut être aggravé par les pratiques de l’éleveur. Serge Zaka met en garde contre les « bâtiments-étuves », pas ou pas suffisamment ventilés, le manque d’ombre dans les pâtures et tout ce qui concourt à augmenter la température au sol.
Le bâtiment, le plus important
Selon le scénario retenu (hausse des températures de + 2 °C « seulement » ou supérieure à 4 °C), le nombre de jours avec un THI stressant sera multiplié par deux ou trois, voire quatre en altitude. Avec des conséquences sur la production laitière journalière et sur les besoins en abreuvement des vaches qui seront multipliés par deux ou trois.
Pour limiter l’impact agricole du changement climatique, Serge Zaka appelle à combiner solutions d’adaptation et d’atténuation. Le bâtiment est, à son sens, l’élément le plus important : il est souhaitable de réaliser un diagnostic thermique afin d’identifier les points d’amélioration. Un bâtiment isolé, avec une bonne circulation de l’air, des dispositifs de ventilation et de brumisation, permettra aux animaux de mieux supporter le stress thermique. L’ouvrir aux heures fraîches favorisera la récupération nocturne. Planter des arbres autour évitera l’impact direct du soleil.
Des races plus résistantes
D’autres mesures concernent la gestion du troupeau et de l’alimentation. Une ration avec moins de cellulose et plus de protéines est recommandée. Le maïs grain humide et le sorgho sont à privilégier, au détriment du blé et de l’orge. Faire pâturer aux heures fraîches, distribuer des compléments alimentaires pour la gestion de la flore du rumen, renforcer l’abreuvement font également partie des préconisations chez les laitières. Le choix des races est aussi à prendre en considération. Des recherches sont en cours sur le sujet, signale Serge Zaka, précisant que les races à viande sont plus résistantes à la chaleur que les races laitières. Chez ces dernières, les animaux à gros gabarit et très productifs semblent moins bien armés. D’où la réorientation attendue de la production laitière vers l’ovin et le caprin après 2050. La baisse de la production de fourrages liée au changement climatique pourrait aussi entraîner une diminution du cheptel.
Faut-il sécuriser la production de maïs fourrage par l’irrigation ? À cette question complexe, Serge Zaka ne veut pas apporter de réponse « binaire ». En France, il faudra irriguer de plus en plus pour assurer la production agricole, dit-il. Mais « il faudra en parallèle travailler sur les systèmes agricoles » : l’agriculture de conservation permet de gagner 7 à 10 jours d’eau, dit-il à titre d’exemple. Un travail sur la génétique variétale, sur des espèces moins consommatrices en eau, telles que le sorgho, lui semble également nécessaire.
Luc Delaby, Inrae : Faire coïncider l’offre fourragère à la demande du troupeau
Partant du constat que les moindres précipitations estivales associées à des températures plus élevées font courir un risque de pénurie fourragère, Luc Delaby, ingénieur de recherche à l’Inrae, a donné des pistes pour adapter le système fourrager et la conduite du troupeau :
Opter pour des cultures plus résistantes, semer des prairies plus adaptées à la chaleur, et « dans les petites terres où certaines prairies risquent de dépérir, ne pas hésiter à faire du sursemis».
Faire preuve d’opportunisme : récolte de mélanges céréales-protéagineux immatures, de dérobées d’été...
Pratiquer le pâturage tardif d’automne, ou précoce de fin d’hiver. D'autant que, sous l’effet du changement climatique, la période adapée au pâturage est plus longue.
Lever le pied sur les objectifs de production lorsque l’offre en fourrage de qualité est en berne. Par exemple, en passant à la mono traite, au tarissement précoce, en adaptant le chargement.
Augmenter la surface fourragère stockée : semer davantage de maïs et décider de sa destination à l’automne, récolter des mélanges céréales-protéagineux avant l’été.
Produire et valoriser l’herbe aux périodes favorables, donc fertiliser plus tôt, et davantage, « pour stimuler la production d’herbe au printemps afin de faire une bonne première coupe avant le pâturage». À noter aussi qu’après une période de sécheresse, les premières pluies stimulent la minéralisation du sol, ce qui permet de produire une herbe de très bonne qualité : « Cette herbe d’automne qui fait suite à une sécheresse marquée, c’est une ration complète. Mais pour en profiter, il faut laisser à la prairie le temps de se régénérer ».
Faucher et stocker plus au printemps.
Valoriser le potentiel des saisons plus favorables à la pousse de l’herbe, soit la fin d’automne et la fin d’hiver.
À cette fin, Luc Delaby a détaillé la technique de la double saison de vêlage, qui consiste à faire synchroniser le pic de production d’herbe avec les vêlages, afin que la demande du troupeau soit maximale lorsque la production d’herbe est maximale, et d'avoir un troupeau avec une faible demande alimentaire pendant les périodes de pénurie, donc en plein été et en hiver. Concrètement, cela consiste à mettre en place deux saisons de vêlage espacées de 6 mois, qui ne durent que deux mois, suivies de deux mois de reproduction. Et à tarir la moitié des vaches laitières simultanément, pour décharger les herbages. Cela permet d’alimenter distinctement les taries et les vaches en lactation, donc de réserver les meilleurs fourrages aux secondes. « L’objectif est d’éviter les vêlages en été, mais de les avoir en mars-avril et septembre-octobre grâce à des inséminations en juin-juillet et décembre-janvier », résume Luc Delaby, qui conclu en encourageant à « anticiper le risque climatique, à imaginer des solutions pérennes et à faire preuve d’humilité pour assurer l’autonomie de l’élevage ».
Florian Leiber, FiBL : Nourrir qui, avec quoi ?
Florian Leiber, de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique suisse FiBL, a tenté de dresser un état des lieux de l’impact de l’élevage sur le changement climatique. Un exercice compliqué, tant les résultats peuvent différer en fonction des éléments qui sont pris en considération. Une chose est sûre : « le thème du méthane émis par les ruminants est fondamental ». La réduction de ces émissions a fait l’objet de nombreuses études qui ont abouti à diverses solutions. L’adjonction de 3-NOP dans les rations est « très prometteuse » car elle permet de réduire les émissions de méthane sans impact sur la qualité du lait ni sur la santé de l’animal. Par contre, « il semble y avoir une adaptation de la flore du rumen qui réduit l’efficacité du 3-NOP à long terme ». L’efficacité de l’adjonction d’extraits de tanins, d’huiles essentielles aux fourrages est aussi testée, mais repose sur des bases scientifiques « assez faibles ». Autre piste : les additifs végétaux, extraits de tout un tas de matières, comme la chicorée, le noisetier, le marronnier… Une méta analyse du FiBL met en évidence des effets « souvent minimes » à mettre au regard de surfaces nécessaires à la culture de ces végétaux, souvent énormes au regard des bénéfices, ce qui en fait une piste « peu réaliste ».
Une autre piste pourrait consister à intensifier l’alimentation du bétail avec plus d’amidon et moins de fibres, pour conduire à de meilleures performances et de moindres émissions de méthane. Sachant que « les ruminants produisent autant de protéines comestibles que le porc et la volaille, mais en consommant davantage de terres arables. » Et que « deux tiers des terres arables de la planète sont occupées par des prairies permanentes ». Alors : « Peut-on se permettre de laisser les ruminants faire concurrence à l’alimentation humaine directe ? De ne pas exploiter davantage les prairies permanentes ? » Pour Florian Leiber, « on n’en fera pas l’économie » mais « il y a deux approches ». La première, « feed no food », consiste à considérer qu’il ne faut consacrer aux animaux d’élevage ni aliment ni terre qui pourrait servir directement à l’alimentation humaine. La seconde consiste à considérer plus globalement l’objectif de neutralité climatique, où l’agriculture a un rôle à jouer.
Pour Florian Leiber, il s’agit de trouver un équilibre entre les deux approches. Dans la balance, il faut mettre plusieurs éléments. Les importations de protéines et la consommation de terres arables que leur production représente. Le degré d’exploitations des pâturages : « Dans certaines régions du globe, il y a trop d’animaux par hectare, ce qui entraîne une destruction de la couverture herbacée, et une érosion des sols qu’on ne peut plus cultiver. Dans d’autres régions, dont l’Europe, ce serait plutôt le contraire, avec un embroussaillement des prairies qui ne sont plus entretenues. » Le fait que modifier l’alimentation du bétail peut entraîner des conséquences sur la fertilité, ce qui impacte aussi l’efficacité des ressources…
Florian Leiber résume : « Si l’alimentation semble bien être une clé de la protection du climat, il reste à trouver la serrure, c’est-à-dire : qui nourrit-on ? Et avec quoi ? La réponse se situera sans doute dans la valorisation des surfaces avec les espèces animales les plus pertinentes et les plus adaptées aux différentes régions, notamment en fonction de la valeur des sols… »
Estelle Leroux, Chambre d'agriculture Alsace et Laura Dale, LKV Bade-Wurtemberg : ouvrir et ventiler les bâtiments pour limiter les pertes économiques
Les biostatisticiennes Estelle Leroux, de la Chambre d'agriculture Alsace et Laura Dale, du LKV Baden Württemberg, ont présenté les résultats de leurs travaux sur le stress thermique, obtenus grâce à des données collectées par des stations météo situées en Alsace et dans le Bade-Wurtemberg et dans des bâtiments d’élevage. Des données qui ont permis de déterminer comment le type de bâtiment influence l’ambiance intérieure, d’étudier l’effet du stress thermique sur le spectre du lait… Il apparaît notamment que le plus efficace pour réduire le stress thermique est d’ouvrir le bâtiment, et ensuite de ventiler mécaniquement. L’étude met aussi en évidence une corrélation entre stress thermique et diminution de la quantité de lait produite, plus marquée en plaine. Un impact sur la qualité du lait, notamment une baisse des taux, est aussi mis en évidence, avec un impact économique estimé à une perte de 3 €/j/vache en moyenne sur les 16 élevages étudiés.