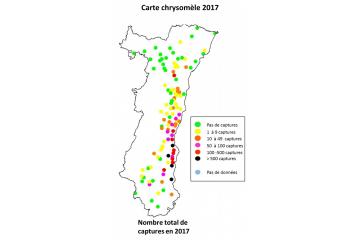Le projet Ermes (Évolution de la ressource et monitoring des eaux souterraines) vise à dresser un état des lieux de la qualité des eaux de la nappe phréatique d’Alsace et des aquifères du Sundgau. Il est réalisé par l’Aprona, en partenariat avec la Région Grand Est et l’Agence de l’eau Rhin Meuse. Au total, près de 400 paramètres ont été analysés : nitrates, chlorures, produits phytosanitaires, métaux, métalloïdes, dioxines, furanes, PCB, substances pharmaceutiques, adjuvants alimentaires… Dans un premier temps, l’Aprona a réalisé l’analyse des résultats obtenus sur les nitrates et les produit phytosanitaires, qui concernent essentiellement le secteur agricole. Pour les autres polluants, les résultats seront présentés dans un deuxième temps.
Par rapport à la précédente étude de 2009, la méthodologie a quelque peu évolué. 137 substances, correspondant à des produits phytosanitaires ou à leurs métabolites ont été recherchées, contre 43 en 2009. Les prélèvements ont été effectués de mi-août à mi-octobre 2016 dans la couche superficielle de la nappe, soit de 0 à 50 m de profondeur. Le réseau de mesure comprenait 825 ouvrages, 674 sur la nappe d’Alsace et 151 dans les aquifères du Sundgau. Il s’agit de captages d’eau potable, de puits agricoles, de puits d’incendie, de sources… Au total, près de 224 000 mesures ont été analysées. À noter aussi que, depuis 2009, le réseau de mesure a été densifié en bordure ouest de la nappe afin d’obtenir une plus grande finesse d’informations sur cette zone. Mais ce réseau densifié n’a été utilisé que pour affiner les cartes et ajuster les connaissances de cette zone complexe. Pour étudier l’évolution des teneurs, l’Aprona a basé ses calculs sur le réseau non densifié, soit le même qu’en 2009, afin de ne pas créer de distorsions dans les résultats.
Nitrates : du mieux et du moins bon
En ce qui concerne les nitrates, la situation se stabilise globalement depuis 2009. La teneur moyenne en nitrates passe de 25 mg/l à 24,6 mg/l. En 2016, 10,8 % des points dépassent la limite de qualité de 50 mg/l (contre 10,7 % en 2009) et 16,3 % le seuil d’alerte de 40 mg/l (contre 17,8 % en 2009). La cartographie des teneurs en nitrates confirme que certaines zones, déjà identifiées en 2003 puis 2009, sont plus concernées que d’autres par cet enjeu. Il s’agit principalement de la bordure ouest de la nappe phréatique d’Alsace. Cette cartographie révèle que si dans certaines zones la qualité de l’eau s’améliore - notamment dans les secteurs les plus dégradés - dans d’autres elle stagne, voire se dégrade. Dans les aquifères du Sundgau, la teneur moyenne en nitrates est passée de 23,5 à 23,4 mg/l. Et le nombre de points dépassant le seuil d’alerte de 40 mg/l est en recul de 22,4 % à 19,2 %. Là aussi, l’évolution de la situation est géographiquement contrastée.
Globalement, l’étude de l’évolution des teneurs en nitrates dans le temps révèle que depuis 2003, la situation s’améliore doucement. Certes la progression est lente, mais elle se poursuit sur la même lancée. Il s’agit donc d’un résultat très positif, qui démontre que les actions mises en œuvre par la profession agricole en zones vulnérables portent leurs fruits. Ces mesures de lutte contre la fuite de nitrates ont été mises en place avant celles visant à réduire l’impact des produits phytosanitaires. Il est donc assez logique de constater de meilleurs résultats pour les nitrates que pour les produits phytosanitaires.
Produits phytosanitaires : plus de résidus
De 43 substances recherchées en 2009, le panel est passé à 137 en 2016 (113 substances actives et 24 métabolites). En nappe phréatique, il n’y a que 7,2 % des points où la concentration en substances phytopharmaceutiques est inférieure au seuil de détection. La majorité (64,3 %) présente une concentration inférieure à 0,1 µg/l pour une substance ou comprise entre 0,4 et 0,5 µg/l pour la somme. Mais 28,5 % des points de mesure affichent des concentrations en produits phytosanitaires supérieures à 0,1 µg/l, dont 2,8 % de points qui dépassent le seuil de 2 µg/l pour au moins un produit phytosanitaire. 77 des 113 produits phytosanitaires recherchés ont été détectés au moins une fois, et 21 substances dépassent la teneur de 0,1 µg/l. La plupart sont des herbicides ou leurs métabolites. Ce qui paraît logique étant donné que leur application se fait le plus souvent sur le sol, avant la levée des adventices, ou sur de jeunes plantules. Parmi elles, les cinq substances les plus détectées sont l’atrazine, trois de ses dérivés, et la simazine. Les trois substances suivantes sont le nicosulfuron, le S-métolachlore et la bentazone, des substances herbicides autorisées sur maïs et/ou betterave. Avec 15,3 % de points au-dessus de la limite de qualité de 0,1 μg/l, la déisopropyl-déséthyl-atrazine (DEDIA), métabolite de métabolite de l’atrazine, apparaît comme la substance la plus préoccupante : à elle seule elle représente 38 % des points supérieurs à 0,1 μg/l.
Dans les aquifères du Sundgau, il y a à la fois davantage de points où la concentration en substances phytopharmaceutiques est inférieure au seuil de détection (29,1 %), et davantage de points où la teneur en produits phytosanitaires est supérieure à 0,1 µg/l pour une substance ou à 0,5 µg/l pour la somme (39,1 %). 37 des 113 produits phytosanitaires recherchés ont été détectés au moins une fois, et 10 dépassent la teneur de 0,1 µg/l. La fréquence de quantification des substances est similaire à celle de la nappe puisque l’atrazine et ses dérivés tiennent le haut du pavé. Une particularité : la bentazone, une substance active herbicide autorisée sur maïs arrive en 4e position. Au total, 10 molécules présentent des teneurs supérieures à 0,1 µg/l. Il s’agit surtout de l’atrazine et de ses dérivés.
Dans son étude, l’Aprona fait la distinction entre des métabolites dont la toxicité est établie, et qui sont donc intégrés dans le contrôle sanitaire, et 24 autres métabolites, non inclus dans la liste de surveillance de l’état chimique parce que leur toxicité n’a pas été établie. Des avis sont en cours d’élaboration par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pour huit d’entre elles. Et dans d’autres pays (Suisse, Allemagne, Pays-Bas), la teneur en ces molécules n’a pas été reconnue comme un paramètre pertinent pour estimer la qualité de l’eau. Elles ne sont donc pas recherchées dans les analyses d’eau. L’étude de l’Aprona montre que ces molécules sont détectées quasiment partout, et à des concentrations relativement hautes sur une part significative des points de mesure. Dans la nappe phréatique, 61,2 % des points dépassent 0,1 µg/l, dont 6 % étant au-dessus de 2 µg/l. Et 22 des 24 métabolites recherchés sont quantifiés au moins une fois. Cette fois, ce sont les métabolites du S-métolachlore qui sont les plus détectés : au moins un des quatre métabolites du S-métolachlore est quantifié sur 90 % des points de mesure. Dans les aquifères du Sundgau, 53 % des points de mesure dépassent 0,1 µg/l. Et un point est au-dessus la teneur de 2 µg/l. Sur les 21 métabolites analysés, 16 le sont au moins une fois. Là aussi, les substances les plus fréquemment retrouvées sont des métabolites du S-métolachlore.
Des seuils plus souvent dépassés
Voici pour l’état des lieux de 2016. Mais, depuis 2009, la qualité de l’eau de la nappe s’est-elle améliorée ou dégradée ? Pour répondre à cette question, l’Aprona a restreint le champ de son étude aux 43 molécules qui ont été analysées en 2009 et 2016. Le nombre de points exempts de produits phytosanitaires passe de 13,5 à 8,4 %, ce qui s’explique aussi par l’amélioration des performances analytiques des laboratoires. Une augmentation de 2 % du nombre de points dépassant le seuil de 0,1 µg/l est constaté (passant de 11,3 à 13,3 %). Cette augmentation des fréquences de dépassement se vérifie surtout pour le S-métolachlore, le nicosulfuron et la bentazone. En outre, 21 molécules présentent des seuils de dépassement, contre 16 en 2009. Et 38 molécules différentes sont quantifiées en 2016 contre 34 en 2009. Enfin, neuf molécules dépassent pour la première fois le seuil de 0,1 µg/l. Mais ces molécules sont désormais pour la plupart interdites, et restent peu quantifiées (moins de 1 % des mesures).
Dans les aquifères du Sundgau, l’étude de l’évolution des teneurs en produits phytosanitaires de 2010 à 2016 est plus positive car la qualité de l’eau s’améliore globalement pour les 43 molécules considérées. En effet, le nombre de points dépassant 0,1 µg/l diminue de 3,5 %. En outre, 17 molécules sont quantifiées en 2016, contre 19 en 2010. Les deux molécules qui dépassent le plus souvent le seuil de 0,1 µg/l en 2010 comme en 2016 sont l’atrazine et un de ses dérivés, avec, à chaque fois une tendance à la baisse, annonciatrice d’une disparition, certes lente, de cette molécule et de ses dérivés de l’environnement. La troisième molécule qui dépasse le plus souvent le seuil de 0,1 µg/l est l’AMPA, un dérivé du glyphosate. Il est suivi par le glyphosate lui-même (1,3 % des points de mesure).
Des vestiges du passé
L’étude de l’Aprona confirme donc la contamination des eaux souterraines par des substances actives et leurs dérivés. Mais il est intéressant de constater que, parmi les 25 molécules les plus retrouvées, 19 sont retirées du marché depuis 2003 et ne sont donc d’ores et déjà plus utilisées. Il s’agit donc de conséquences de pratiques issues du passé, contre lesquelles l’évolution des pratiques actuelles ne peut pas grand-chose. En outre, toujours parmi ces 25 molécules les plus retrouvées, figurent un certain nombre de métabolites, qui peuvent être toxiques, mais pas forcément. Donc, si on ne considère que les matières actives encore autorisées, le tableau est bien moins sombre. Les substances qui sont le plus détectées sont le nicosulfuron, le S-métolachlore, et la bentazone. Arrive ensuite le bromacil, une molécule désormais retirée du marché et dont la présence dans les eaux souterraines est principalement due à une pollution d’origine industrielle, suite à une fuite dans une usine de fabrication.
La profession agricole mobilisée sur le sujet
La profession agricole a mis en place un certain nombre de mesures afin de réduire son recours aux produits phytosanitaires. Des mesures qui portent leurs fruits puisque la consommation de substances actives (hors soufre et cuivre) est en baisse régulière en Alsace depuis 2010. Une baisse masquée par la hausse de la consommation de soufre et de cuivre, homologués pour lutter contre les ravageurs des cultures en agriculture biologique, et de plus en plus utilisés par les agriculteurs conventionnels aussi, notamment parce que cela leur permet d’utiliser moins de produits de synthèse.
Il y a d’abord des mesures réglementaires, comme le Certiphyto, obligatoire pour manipuler des produits phytosanitaires depuis 2015. Sur les 12 000 exploitations alsaciennes, 9 000 ont été formées. Le gap est constitué des exploitations qui sous-traitent ces travaux. À cela s’ajoutent les contrôles des pulvérisateurs, obligatoires tous les cinq ans, et qui visent à vérifier la conformité du matériel utilisé.
Dans le cadre du Plan végétal pour l’environnement (PVE), un dispositif national dont les objectifs sont la réduction de l’impact des produits phytosanitaires et la consommation d’énergie par l’activité agricole, les agriculteurs ont pu bénéficier d’aides à l’investissement dans du matériel plus performant, ou encore des aires de lavage des pulvérisateurs. Un dispositif qui a été bien utilisé puisqu’entre 2009 et 2015 près de 2 000 investissements ont été subventionnés. En tête de ce dispositif arrivent les outils de désherbage mécanique, suivis par les systèmes de guidage par GPS, et les aires de lavage et de remplissage des pulvérisateurs. Ce qui a permis de réduire à la fois les pollutions diffuses, grâce à une meilleure gestion des tourières, des coupures de tronçon… et les pollutions ponctuelles en évitant les débordements de cuve, le rinçage vers les réseaux.
Cela fait aussi plus de 20 ans que la profession agricole a mis en place des opérations Agri-Mieux et Ferti-Mieux, dans le cadre desquelles des pratiques agricoles alternatives sont testées et diffusées en zone vulnérable. Dans les zones de captages prioritaires, s’ajoutent à cela des conseils individuels et la contractualisation de Mesures agroenvironnementales (MAE) sur près de 13 000 ha.
Les conseils émanant de la Chambre d'agriculture d’Alsace (CAA), notamment via ses bulletins techniques, intègrent désormais systématiquement des mesures de techniques alternatives. Et des formations sont régulièrement proposées aux agriculteurs pour aller vers des techniques de traitement plus efficientes et économes. En outre, des essais sont conduits afin de trouver des alternatives aux produits phytosanitaires. Ainsi, des matières actives moins sujettes au risque de transfert vers les eaux souterraines que le S-métolachlore ont été testées, avec des efficacités correctes, notamment sur les graminées, dont le niveau d’infestation doit être maîtrisé au risque de voir le stock semencier du sol augmenter.
Depuis 2010, dans le cadre du plan Écophyto, des groupes d’agriculteurs se sont créés afin de réduire leur dépendance aux produits phytosanitaires de synthèse. Il s’agit du réseau de ferme Dephy (lire aussi en pages 5 et 14), bien développé en Alsace avec 24 maraîchers, 25 viticulteurs et 26 agriculteurs. Dans les fermes Dephy du Nord Est, entre 2010 et 2015, l’Indice de fréquence de traitement (IFT) a été réduit de 12 % en grandes cultures et polyculture élevage, 30 % en cultures légumières 17 % en viticulture et 6 % en arboriculture.
En 2016, une convention territoriale d’engagement entre les prescripteurs a été signée à l’échelle alsacienne pour des actions correctives et préventives sur les ressources en eau. 32 signataires représentant l’ensemble des filières agricoles sont concernés. Cette convention permet notamment des échanges entre les conseillers agricoles et les technico-commerciaux des négoces sur les résultats des analyses d’eau des captages et les programmes de désherbage afin d’aboutir à des conseils communs propres à faire évoluer les pratiques des agriculteurs.
Les conversions à l’Agriculture biologique (AB) sont encouragées. La profession cherche aussi à construire de nouvelles filières à bas intrants, notamment de production de biomasse, mais aussi des circuits courts valorisant les produits de l’élevage, propres à maintenir les surfaces en herbe. Enfin, la CAA étudie la possibilité d’intégrer de « nouvelles » cultures peu exigeantes en intrants dans les assolements.
Des résultats à compléter
En ce qui concerne les nitrates, les efforts portent leurs fruits et doivent donc être maintenus, voire intensifiés, notamment dans les zones sensibles. L’amélioration du spectre de produits phytosanitaires détectés dans l’eau passera sans doute par un changement de système, qui devra être adapté au public et au territoire. La réponse sera donc forcément plurielle. Il faudra être vigilant quant aux résultats qui seront obtenus pour les autres polluants et prendre les mesures qui s’imposent dans tous les domaines. En effet, la priorité qui a été donnée à la publication des résultats sur les nitrates et les produits phytosanitaires ne doit pas jeter l’opprobre sur une catégorie socioprofessionnelle, et faire oublier que, au-delà de l’activité agricole, la pollution mesurée résulte de bien d’autres facteurs qui interfèrent avec notre environnement quotidien. Enfin, si la nappe phréatique alimente en eau potable 80 % de la population alsacienne, les résultats énoncés plus haut ne reflètent pas la qualité de l’eau potable distribuée aux robinets, qui fait l’objet de traitements destinés à garantir une qualité conforme aux critères de potabilité.