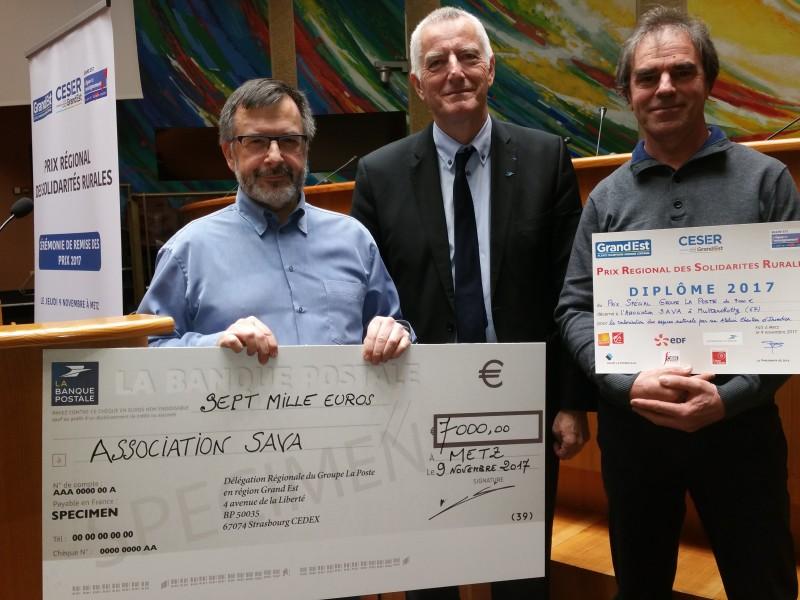Irrespect, non-reconnaissance, colère, incompréhension… Les retraités agricoles sont à bout. Et ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi le Gouvernement semble rester si sourd à leurs revendications - à savoir une revalorisation de leur pension à 85 % du Smic - alors qu’il s’est engagé fin avril, par la voix d’Emmanuel Macron, à assurer un minimum de 1 000 € par mois pour tous les retraités français, dont agricoles… en théorie. « C’est une mesure qui va dans le bon sens pour ceux qui partiront en retraite à partir de 2020, mais pas pour les indépendants manifestement. Et elle n’apporte aucune réponse aux plus faibles pensions perçues aujourd’hui par les anciens agriculteurs. Et nous, nous voulons une solution maintenant pour eux, pas en 2025 », explique Alain Lecler, président de la Section régionale des anciens exploitants (SRAE) du Grand Est. Ils sont actuellement 1,3 million à toucher une retraite moyenne de 760 € par mois, soit 100 € de moins que le minimum vieillesse établi à 868 €, et plus de 600 € de moins que la retraite moyenne de l’ensemble des Français, qui atteint actuellement 1 380 € par mois.
85 % du Smic, une promesse de… 2002
Lassés d’être en permanence les laissés-pour-compte du système de retraite français, les anciens exploitants ont décidé d’agir et de faire entendre leur désarroi au plus haut sommet de l’État. Dans chaque département, les sections des anciens des FDSEA, aux côtés des FDSEA, ont remis en mains propres à chaque préfet et à des parlementaires un courrier (lire encadré) destiné à Emmanuel Macron et son équipe afin de leur faire comprendre « l’état d’urgence » concernant les retraites agricoles. « On cherche une solution pour que les gens comprennent la situation dans laquelle on est. Là, on passe par les interlocuteurs directs du président de la République. On espère qu’on sera entendus cette fois », poursuit Alain Lecler. Le président du SRAE Grand Est fait bien de préciser « cette fois » tant ils ont déjà témoigné leur désespoir aux responsables politiques du pays. À chaque fois, ils ont eu droit à un retour compréhensif et compatissant. Mais derrière, les actes se font attendre. « Les 85 % du Smic, on aurait dû les avoir en 2007 suite à une loi votée à l’unanimité, tous partis confondus, en 2002. Dix-sept ans plus tard, on attend toujours. On n’est même plus aux 75 % du Smic étant donné qu’on n’a pas eu droit à l’inflation », se désole l’Ardennais Robert Henon, vice-président de la SRAE Grand Est et administrateur national dans la section des anciens de la FNSEA. Ce qui fait dire à l’Alsacien Paul Schiellein, également vice-président de la SRAE Grand Est, que les retraités agricoles d’aujourd’hui sont les « oubliés de la Nation ». « On a travaillé toute notre vie pour nourrir ce pays. Et aujourd’hui, les anciens sont très déçus par la non-reconnaissance dont ils sont victimes. »
« Où est la solidarité nationale ? »
Quand les anciens exploitants reviennent à la charge pour redemander les 85 % du Smic qu’on leur a promis au début des années 2000, la réponse est toujours sensiblement la même : cela va coûter « beaucoup d’argent » à l’État. « C’est là que je me dis qu’il y a un gros problème. On renfloue les caisses des mineurs ou des cheminots, mais dans notre cas, la solidarité nationale ne pourrait pas fonctionner. C’est une réponse qui est encore plus difficile à avaler quand on voit que le Gouvernement a réussi à débloquer dix milliards d’euros pour les Gilets Jaunes. Ce n’est qu’une question de volonté finalement », poursuit Robert Henon. Pourquoi, dans ce cas, ne pas avoir rejoint le mouvement contestataire né à l’automne dernier ? « C’est vrai, on aurait pu. Mais on ne voulait pas rajouter à la crise et éviter que cela empire. Pour autant, même si on est restés calmes, cela ne veut pas dire qu’on a le droit de nous oublier », complète le retraité agricole ardennais. Ou tout simplement vu au travers d’un prisme quelque peu déformant de la réalité agricole. « Dans la bouche de certains ministres, c’est normal qu’on ait des petites retraites étant donné qu’on a peu cotisé durant notre carrière. Sauf qu’ils oublient de préciser à chaque fois que c’était parce que l’alimentation était à bas prix », fait remarquer Paul Schiellein.
Un outil de travail, pas une richesse
Sans oublier les sempiternelles remarques sur le foncier et le matériel dont disposent les agriculteurs qui seraient des « nantis » de la société française. « Oui, on exploite des hectares et certains ont des gros tracteurs. Mais tout ça, c’est notre outil de travail ! On a dû s’endetter pour les avoir et ainsi pouvoir répondre aux volumes de production qui nous étaient demandés », clarifie Robert Henon. D’autant plus que tout ce foncier qui serait synonyme de « richesse » garantie pour les agriculteurs doit être cédé ou transmis en quasi-totalité pour pouvoir bénéficier de sa pension de retraite. Seule une parcelle de subsistance, dont la superficie varie d’un département à l’autre, peut être conservée par le néo-retraité agricole. L’inverse de l’Allemagne où le retraité agricole peut continuer à exploiter l’intégralité de sa sole en plus de sa pension, plus faible qu'en France. Grâce à leur système, les Allemands sont gagnants par rapport à nous. Au quotidien, c’est plus facile à vivre », indique Paul Schiellein.
Se battre pour les retraites de demain
À défaut d’une uniformisation des systèmes de retraite européens, on s’oriente aujourd’hui vers une uniformisation de tous les systèmes français. Un objectif de campagne du candidat Macron début 2017 mené tambour battant par Jean-Paul Delevoye, nommé pour l’occasion haut-commissaire à la réforme des retraites. « On a pu le rencontrer. Il nous a entendus et c’est très bien. Mais ça sera pour 2025. Et si le fait d’avoir un euro de retraite pour un euro cotisé est une bonne chose en soi, cela pose tout de même une question de fond pour le monde agricole. Quelle pension vont toucher les futurs retraités quand on voit les revenus actuels ? La moyenne est à 350 € et un agriculteur sur deux gagne un demi Smic. Il y a de quoi s’inquiéter », estime Robert Henon. C’est pour cela que la FNSEA a demandé qu’en cas d’année négative pour l’agriculteur, il ait quand même un minimum de cotisation retraite qui soit pris en charge. En en cas d’année confortable, il puisse faire des réserves non fiscalisées, contrairement à aujourd’hui.