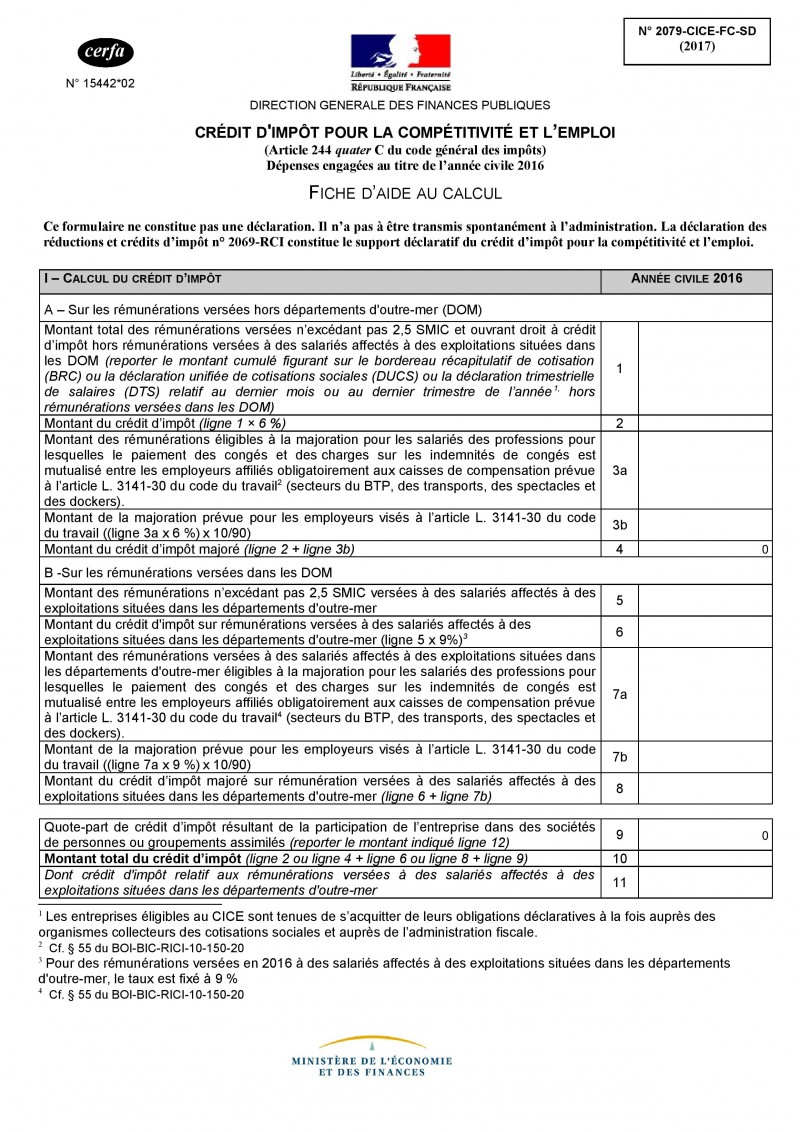Installé sur l’exploitation familiale à Bretten depuis 1990, Gilles Schnoebelen a toujours été producteur de lait. Son secteur, éloigné des grands axes routiers, est dépourvu de laiterie. Depuis cinq ans, sa production est entièrement livrée en Allemagne. Une expérience intéressante…
Âgé de 48 ans, Gilles Schnoebelen est installé avec son épouse Sylvie. Leur fille, Marie, 23 ans en avril, est salariée sur cette exploitation de polyculture élevage. « Quand j’ai succédé à mon père à sa retraite, j’ai poursuivi l’activité laitière. Aujourd’hui, nous faisons en moyenne 800 000 litres avec nos 90 vaches de race holstein et, depuis 15 ans, 25 % en simmental. Une race que j’ai choisie pour sa viande. Nous élevons tout le cheptel et nous vendons peu de veaux. Pour les cultures, nous avons essentiellement du blé et du maïs. Mais, de moins en moins de maïs car les rendements sont en baisse et on a besoin de paille. Les vaches sont en pâture au printemps avec comme première alimentation, l’herbe. Nous avons suffisamment de prés autour de l’exploitation. Nous avons pensé aux circuits courts pour optimiser nos produits, mais Bretten, c’est un peu loin de tout. Et seul, ce n’était pas possible », explique Gilles Schnoebelen.
Un GIEPLSE
Pour l’activité laitière, son père faisait à l’époque la collecte pour Schmitlin avant de se consacrer pleinement à l’exploitation. Suite à Schmitlin, le lait a été livré à la coopérative Alsace Lait puis à la coopérative de Belfort et enfin à la laiterie fromagère Mulin à Besançon pour une durée de sept années à chaque fois. Mais, en septembre 2010, Mulin dénonce le contrat liant les deux parties, voulant récupérer du litrage dans une autre zone géographique.
« Nous nous sommes trouvés devant une dénonciation de contrat de la part du collecteur. La collecte était assurée par un prestataire (Scherrer). Cela nous a permis d’aller voir ailleurs avec la possibilité de faire du rendu quai. On s’est alors tourné vers les laiteries des environs : Ermitage, Sodiaal, Alsace Lait, Lactalis. Toutes nous ont répondu la même chose. Elles n’avaient pas besoin de volumes supplémentaires ou dans des délais qui n’étaient pas adaptés à notre situation. Sans débouché possible en France, on s’est alors tourné vers l’étranger », explique Gilles Schnoebelen.
Dans le même temps, il crée en avril 2011 avec d’autres éleveurs concernés - Christien Schnebelen de Heimersdorf, Thierry Itty d’Altenach, Isabelle Schirck de Novillard dans le Territoire de Belfort, Gilbert Rein à Seppois-le-Bas et Jean Sirlin à Hirsingue - le groupement d’intérêt économique des producteurs de lait du Sundgau et des environs (GIEPLSE).
Jongler avec les règles différentes
« Cela nous a permis d’obtenir un agrément en tant qu’acheteur de lait et ainsi de pouvoir organiser la collecte auprès des adhérents, de faire la gestion des volumes pour FranceAgriMer, de facturer la production de lait et de vendre sur le marché français ou à l’export. » Après un premier contact finalement négatif et des recherches élargies dans une zone géographique plus importante, les éleveurs trouvent un accueil favorable chez Omira, une coopérative allemande dont l’usine la plus proche était située à Rottweil dans le district de Fribourg-en-Brisgau et le siège à Ravensbourg. « Mais, la crise est également passée par là-bas. En 2013, Omira s’est restructurée avec un nouveau conseil d’administration et un nouveau directeur. Le site de Rottweil a été fermé. Nous livrons depuis le lait à Ravensbourg, 70 kilomètres plus loin », explique Gilles Schnoebelen.
La collecte se fait toutes les 48 heures. Scherrer vient chercher le lait en tant que prestataire pour Omira. « Les débuts ont été laborieux. Comme c’était du lait exporté, nous avons rencontré des difficultés avec l’administration française pour avoir toutes les autorisations. Aujourd’hui encore, il faut jongler avec les règles différentes dans les deux pays. Les analyses de lait réalisées par les laboratoires allemands par exemple, ne sont pas reconnues par la France alors que l’on a les mêmes normes Iso. Nous sommes donc obligés de faire des analyses sanitaires en France que nous payons, évidemment, environ 1 000 € par an. Concernant le paiement du lait, c’est différent en Allemagne. Il faut respecter les normes en vigueur. Il n’y a pas de classification intermédiaire. Ou tu es bon ou tu ne l’es pas. Le paiement allemand est plus simple qu’en France. Il n’y a pas d’engagement à faire sur du volume. Nous appliquons la grille allemande en respectant la réglementation européenne », ajoute Gilles Schnoebelen.
En moyenne, peu d’écarts de prix
En tout, ce sont 32 producteurs de lait français, essentiellement situés dans le Sundgau et dans le nord du Territoire de Belfort, qui livrent leur lait en Allemagne. Ils représentent 14 millions de litres. Mais comme en France, la crise du lait est une réalité en Allemagne. Elle a même touché plus durement le prix outre-Rhin en raison d’une plus forte réactivité du marché. Le prix est fixé mensuellement en fonction du marché national et des ventes de la laiterie.
« Un exemple. On a bien vendu en décembre et du coup le prix du lait augmente en janvier. Il n’y a pas de lissage des prix. Il y a parfois des primes de 10-15 € qui viennent des acheteurs comme Lidl ou Nestlé. On a connu le meilleur avec 420 € les 1 000 litres en 2014 (à l’époque en France, ce prix était de 380 €/1 000 l) et le pire avec 225 €/1 000 l en juin 2016 (en France, 265 €/1 000 l). Si nous prenons une moyenne quinquennale, il y a peu d’écart de prix entre les deux pays. En 2016, nous sommes malheureusement largement en dessous du prix français. En novembre dernier, nous étions, comme en France, à 290 €/1 000 l et là, nous devrions repasser les 300 €/1 000 l. »
« Cette expérience est intéressante car elle nous a permis de voir ce qui se fait autour de nous, aussi bien du côté des producteurs que du côté des laiteries. Nous voyons une autre gestion de la filière, très différentes de l’organisation française, même si la frontière est toute proche. La non-contrainte du volume nous permet d’atténuer l’effet de la baisse du prix du lait. Pour être là demain, il faudra faire du volume. Ce qui est possible en Allemagne et pas en France où l’on bride les exploitants performants. Personnellement, je n’ai donc pas envie de revenir en arrière même si, en 2017, nous comptons reprendre contact avec les laiteries françaises pour, éventuellement, avoir la possibilité de partager les volumes et avoir ainsi deux sorties pour notre lait », conclut Gilles Schnoebelen. Dans tous les cas, c'est en assemblée générale que les grandes décisions sont prises. Qu'importe ce que l'avenir lui réserve, l'éleveur souhaite garder sa liberté dans ses décisions acquise par cette expérience.